- Loïc ALOISIO
- L’évolution des ressorts didactiques dans la littérature de science-fiction chinoise
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Alain BACCI & Jérémie SEGOUAT
- Traduction scientifique spécialisée en Langue des Signes Française : projet d’application dans le cadre de la formation au D-TIM
- Mots clefs
- Pier-Pascale BOULANGER
- Le film de finance et la fabrique d’une « coolture »
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Corpus
- Romuald DALODIERE
- Voyage initiatique et langue de spécialité : le parcours d’un viking analysé au prisme de la textométrie
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Oeuvre analysée
- Julien DEGUELDRE
- Doit-on couler le drakkar ?
- Références bibliographiques
- Lorenzo DEVILLA & Nicla MERCURIO
- Malts d’orge cara, houblons simcoe, dry hopping : les terminologies de la bière sur les RSN français et italiens entre expert∙e∙s et grand public
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Mustapha KHIRI & Lamya CHOUKY
- Le processus de vulgarisation du français médical sur les réseaux sociaux : la métaphore dans la langue médicale pédiatrique populaire au Maroc
- Mots clefs
- Natascia LEONARDI
- How it came about that humans think that Martians may exist
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Laura MARTIN-GOMEZ
- De la science en fantasy : lectures scientifiques de l’œuvre de Tolkien
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Andrew McMURRY
- Science Communication from the Dead to the Living: Zombie Discourse and Vaccine Skepticism
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Camilla NAPPI
- La culture populaire à l’ère numérique : analyse des discours de vulgarisation de l’art sur Instagram
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Vanessa PAOLI
- La langue juridique dans les romans de Gianrico Carofiglio
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Raffaele PIZZO
- The Popularisation of the Language of Chemistry: The Use of LSP in Online Cosmetics Advertising
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Joëlle POPINEAU
- Dissémination juridique dans les séries juridico-criminelles américaines et britanniques. Vers une exploration terminologique des transcriptions
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Références des séries télévisuelles étudiées
- Chiara PREITE
- La vulgarisation scientifique dans le Reel : le cas de la « fisica che ci piace »
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Natalia RIVA
- Enhancing Health Literacy and Specialized Language Popularization through Chinese Medical TV Dramas
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Micaela ROSSI
- Des métaphores visuelles dans la vulgarisation scientifique : deux études de cas dans un corpus de bandes dessinées
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Marine VERRIEST
- L’hypothèse Sapir-Whorf au prisme de la science-fiction
- Mots clefs
- Références bibliographiques
- Doan VU DUC
- Comment les Schtroumpfs font-ils pour se schtroumpfer quand ils schtroumpfent ? / (Comment les Schtroumpfs font-ils pour se comprendre quand ils parlent ?)
- Gloria ZANELLA
- Les métaphores dans les ouvrages de vulgarisation de Carlo Rovelli : une étude sur corpus parallèle en français et italien
- Mots clefs
- Références bibliographiques
Résumés des communications
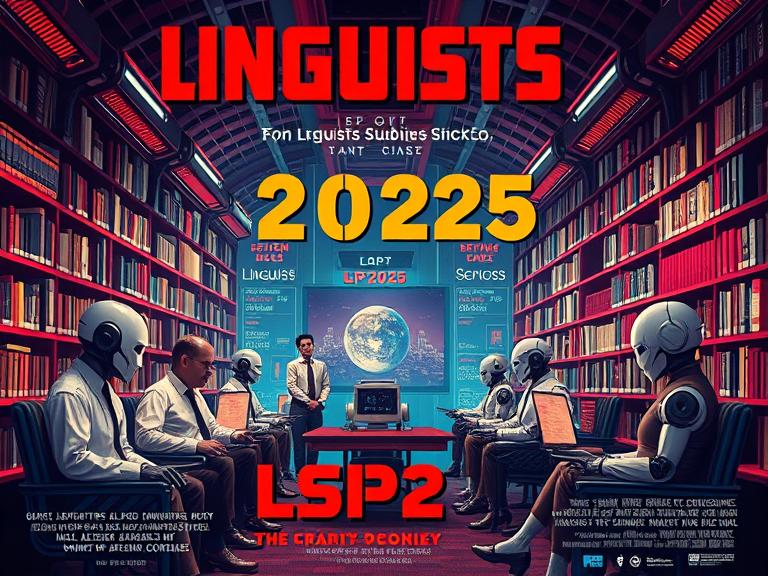
Loïc ALOISIO
Université de Mons (Belgique)
L’évolution des ressorts didactiques dans la littérature de science-fiction chinoise
Comme le souligne Irène Langlet (2006 : 38), « l’articulation d’un novum et de son “explication” est le véritable moteur du texte science-fictionnel ». Cette explication est généralement réalisée à l’aide de langues de spécialité et par le biais de « manœuvres explicatives » (Langlet 2006 : 38) et de « stratégies didactiques » (Saint-Gelais 1999 : 141). L’utilisation de ces langues de spécialité est un aspect fascinant et essentiel qui peut enrichir les récits de science-fiction tout en ancrant les idées qu’ils développent dans des contextes scientifiques, techniques et culturels précis. Les langues de spécialité constituent ainsi, pour l’auteur de science-fiction, un outil puissant lui permettant de créer des univers crédibles, d’enrichir la narration, d’explorer des technologies et concepts complexes, et de mettre en lumière des enjeux sociétaux. Plus que simples objets du décor, elles sont au cœur de l’expérience de lecture et deviennent un véritable vecteur de réflexion et d’imagination. Bien entendu, la science-fiction chinoise ne fait pas défaut et a su intégrer et faire usage, tout au long de son histoire, d’éléments didactiques variés et de langues de spécialité diverses. Souvent accompagnée d’un désir d’éduquer le lecteur, que ce soit dans les domaines scientifiques, politiques ou idéologiques, l’utilisation des langues de spécialité dans la science-fiction chinoise a toujours été le reflet d’un dialogue constant entre tradition et modernité, entre fiction et réalité. Le caractère didactique de la science-fiction s’est vu particulièrement renforcé dans le contexte chinois, où l’imaginaire a parfois été considéré comme un formidable outil d’éducation des masses. Nous nous attacherons donc, dans cette communication, à présenter l’évolution des ressorts didactiques et de l’usage des langues de spécialité utilisés par les auteurs de science-fiction chinois de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, et ce que celle-ci implique concernant la poétique et la lecture de ces œuvres littéraires.
Mots clefs
Ressorts didactiques ; science-fiction ; Chine ; langue de spécialité ; Histoire
Références bibliographiques
DIÉNY, Jean-Pierre. (1971). Le Monde est à vous. La Chine et les livres pour enfants. Paris : Gallimard, coll. « Témoins ».
JIANG, Qian. (2013). « Translation and the Development of Science Fiction in Twentieth-Century China ». Science Fiction Studies 119(40), pp. 116-132.
LANGLET, Irène. (2006). La Science-fiction : lecture et poétique d’un genre littéraire. Paris : Armand Colin, coll. « U ».
LEPLÂTRE, Florine. (2017). « Usages du futurisme médical en Chine pré-républicaine : craniotomie et régénération dans deux récits de science-fiction (1904-1905) ». ReS Futurae 9. http://journals.openedition.org/resf/998
PESARO, Nicoletta. (2019). « Contemporary Chinese Science Fiction: Preliminary Reflections on the Translation of a Genre ». Journal of Translation Studies 3(1), pp. 7-43.
RUMPALA, Yannick. (2015). « Littérature à potentiel heuristique pour temps incertains. La science-fiction comme support de réflexion et de production de connaissances ». Methodos 15. http://journals.openedition.org/methodos/4178
SAINT-GELAIS, Richard. (1999). L’Empire du pseudo. Modernités de la science-fiction. Québec (Québec) : Nota Bene, coll. « Littérature(s) ».
ZHANG, Florence Xiangyun. (2016). « Relier la science à la littérature. La traduction de Jules Verne en chinois ». In Patricia PHILLIPS-BATOMA & Florence Xiangyun ZHANG (dirs.). Translation as Innovation. Bridging the Sciences and Humanities. Dublin : Dalkey Archive Press, pp. 279-295.
Alain BACCI & Jérémie SEGOUAT
D-TIM / CLLE – Université Toulouse Jean Jaurès / CNRS (France)
Traduction scientifique spécialisée en Langue des Signes Française : projet d’application dans le cadre de la formation au D-TIM
Le département de Traduction, Interprétation et Médiation (D-TIM) forme des interprètes français-langue des signes française (LSF), des traducteurs français LSF et des médiateurs en LSF. Les étudiants de ces différentes options collaborent dans le cadre de projets professionnalisant, mis en place avec des partenaires, pour mettre leurs compétences au service de la réussite des projets. Les compétences et connaissances employées sont travaillées pour partie dans des cours de la formation, notamment pour leur apprendre à investir de nouveaux domaines de connaissance et créer de nouvelles solutions adaptées aux besoins du partenaire. Ainsi le D-TIM propose des cours de langue de spécialité en traduction et interprétation, pour acquérir des stratégies de préparation, et de réalisation des traductions en domaines inconnus ou moins familiers. Tous les domaines de spécialité ne peuvent pas être traités dans les cours, c’est donc aux étudiants de trouver les ressources nécessaires à la réalisation des projets, chez le partenaire, ou dans d’autres réseaux professionnels.
Le projet Science Comedy Show, mené sur les deux dernières années, met en lumière un travail de traduction en LSF dans un contexte de vulgarisation scientifique, où un travail a été particulièrement mené sur la traduction des termes mais également sur la mise en scène de ces traductions, particulièrement originale.
Science Comedy Show (SCS) est une troupe de théâtre composée d’une vingtaine de comédiens, tous docteurs ou doctorants, œuvrant dans de nombreuses disciplines. Elle se donne pour vocation de sensibiliser le grand public et les jeunes à la science. Elle organise de nombreuses actions : théâtre interactif, jeux en présentiel et sur internet, ateliers de partage de connaissances. Parmi toutes celles-ci, le projet “Dealers de Sciences” a fait l’objet d’un partenariat avec le D-TIM. SCS a réalisé plus de 200 cartes vidéos qui alimentent un jeu en ligne. Quel est ce jeu ? Les joueurs se déplacent soit à Toulouse, soit à Poitiers. L’application les géolocalise et leur signale qu’il y a des cartes à gagner. Chaque carte donne une information de nature scientifique présentée sous une forme ludique par un comédien costumé. Les joueurs capitalisent les cartes jouées et peuvent les échanger avec d’autres joueurs. Actuellement le jeu est présenté en français, mais des versions anglaises et espagnoles sont en cours de développement. Le D-TIM collabore à la réalisation d’une version en LSF. Une équipe d’une dizaine d’étudiants s’est réunie deux années d’affilée pour étudier les textes de vulgarisation scientifique en français, et pour concevoir une version en LSF. La première année a été consacrée à structurer la méthode de travail : analyse des textes, recherche sur les concepts scientifiques, entraînement puis tournage d’une dizaine de clips mis à disposition de SCS pour intégration dans le jeu vidéo. La deuxième année, le projet a été repris par de nouveaux étudiants, qui ont amélioré le processus de création. Une évaluation du point de vue utilisateur est en cours de réalisation. Elle va permettre de vérifier l’intelligibilité des cartes vidéos en LSF et la dimension ludique de cette activité.
Mots clefs
Langue des signes française ; traduction scientifique ; projet d’enseignement ; quizz géolocalisé
Pier-Pascale BOULANGER
Université Concordia (Canada)
Le film de finance et la fabrique d’une « coolture »
Il n’est pas rare que les récits financiers soient portés à l’écran. Deux films qui ont vulgarisé les complexités de la finance nous intéressent. Le premier, The Big Short (2015), est une adaptation du livre The Big Short: Inside the Doomsday Machine (Lewis, 2010), qui expose les arcanes des instruments dérivés de crédit derrière la crise financière de 2008. L’autre film, Dumb Money (2023), est adapté du livre The Antisocial Network: The GameStop Short Squeeze and the Ragtag Group of Amateur Traders That Brought Wall Street to Its Knees (Mezrich, 2021). Ce récit de David et Goliath explique comment une communauté de petits investisseurs liés par les réseaux sociaux a gagné son pari contre de riches fonds d’investissement.
Dans le passage du livre à l’écran, quelles sont les occurrences de traduction intralinguale et intersémiotique qui servent à faire comprendre les rouages de la finance au public non initié ? En quoi diffèrent-elles ? L’analyse contrastive portera sur les séquences que les films The Big Short et Dumb Money consacrent à l’explication de produits et techniques complexes de la finance :
• la titrisation du prêt hypothécaire à risque (subprime loan securitization)
• le titre adossé à des créances obligataires (collateralized debt obligation)
• le swap sur défaillance de crédit (credit default swap)
• vendre à découvert (to short)
• la liquidation forcée des positions courtes (short squeeze).
D’emblée nous voyons que la vulgarité est mise au service de la vulgarisation dans le jeu d’acteurs souvent irrévérencieux, qui qualifient de « shit » les produits financiers opaques et risqués. L’humour et l’ironie constituent d’autres capteurs d’attention qui sont beaucoup moins prononcés dans les livres, mais essentiels à l’efficacité d’une explication livrée à l’oral. Si les paroles des acteurs reprennent les marqueurs de vulgarisation courants à l’écrit, telle la subordonnée relative explicative which means, une multitude de signes interagissent par les codes du cinéma : métaphores visuelles, objets manipulés par les acteurs, explications adressées directement au public, définitions écrites projetées en intertitres, gros plans sur les commentaires colorés tirés de réseaux sociaux, dialogues en question-réponse, voix off, etc. Les adjuvants de la vulgarisation foisonnent. Aussi notre étude s’appuiera-t-elle sur l’analyse filmique et multimodale, ancrée dans la théorie socio-sémiotique de Kress et van Leeuwen, qui ne perdent jamais de vue les rapports de force sociétaux dans la grammaire du design visuel (2006 [1996]).
Parce que leur discours est critique, voire anti-establishment, ces productions culturelles contribuent à la fabrique de ce que nous appelons une « coolture », une culture populaire qui a la cote. Nous croyons que ce phénomène participe à la popularisation de la finance, par ailleurs propulsée par des applis mobiles en phase avec une clientèle jeune (millénariale et génération Y). Les sociétés de technologie financière Robinhood (aux États-Unis) et WealthSimple (au Canada) ont rendu la négociation boursière conviviale et gratuite. Cette « démocratisation » des marchés financiers (WealthSimple, 2020) marque sans aucun doute l’intensification du capitalisme financiarisé.
Mots clefs
Terminologie financière ; adaptation cinématographique ; procédés de vulgarisation ; analyse sémiotique contrastive ; popularisation de la finance
Références bibliographiques
Kress, Gunther et Theo van Leeuwen (2006 [1996]). Reading Images: The Grammar of Visual Design, 2e édition. Londres : Routledge.
WealthSimple (2020). Half a Million Mikes. https://youtu.be/fypQIkUKgUE.
Corpus
Gillespie, Craig (2023). Dumb Money. Columbia Pictures.
Lewis. Michael (2010). The Big Short: Inside the Doomsday Machine. New York : W.W. Norton & Company.
McKay, Adam (2015). The Big Short. Paramount Pictures.
Mezrich, Ben (2021). The Antisocial Network: The GameStop Short Squeeze and the Ragtag Group of Amateur Traders That Brought Wall Street to Its Knees. New York : Grand Central Publishing.
Romuald DALODIERE
Université de Mons (Belgique)
Voyage initiatique et langue de spécialité : le parcours d’un viking analysé au prisme de la textométrie
Publié en 2017, le premier tome de la série norvégienne écrite par Bjørn Andreas Bull-Hansen, Jomsviking, raconte les aventures du jeune Torstein, qui quoique réduit en esclavage à l’aube de son adolescence, saura s’extraire du destin funeste auquel il est promis pour s’élever au rang de guerrier accompli et estimé de ses pairs au sein des prestigieux vikings de Joms. Dans ce récit qui se présente comme un roman historique, l’émancipation du héros passe par sa libération, sa vengeance, mais aussi la construction de son identité : d’esclave, il devient tout à la fois charpentier naval, marin, forgeron et guerrier, se déplaçant au gré des nécessités entre différents lieux de l’Europe du Nord. De victime, il devient artisan prisé, ami fidèle et combattant redoutable, dans un monde où les positions sociales sont particulièrement codifiées et les alliances susceptibles de se faire et se défaire en fonction des circonstances. Le premier tome de cette série, qui met au centre les thèmes de la jeunesse et de la transformation sociale et acte l’évolution de Torstein et son cheminement vers la maturité, peut être qualifié de roman de formation (Moretti, 2019).
En l’occurrence, c’est de la formation d’un viking, figure majeure de la pop-culture, dont il est question. Convoquer la figure du viking, c’est convoquer une série de représentations dont il est difficile de se passer : son fameux navire, notamment, fait partie de ceux-ci, aux côtés d’autres éléments qui, pour stéréotypés qu’ils soient, contribuent à donner du réalisme à l’œuvre. Or, si le réalisme est une fonction centrale du roman historique (Durand-Le Guern, 2008), le critère de véracité de tels romans s’établit autour de deux notions, l’authenticité et l’exactitude (Saxton, 2020). Dans le roman de Bull-Hansen, la volonté d’authenticité se construit notamment autour de la langue de spécialité, particulièrement présente dans les chapitres se concentrant strictement sur l’acquisition de compétences par le personnage, de sorte que la terminologie paraisse baliser certaines étapes du voyage de Torstein.
L’analyse de la langue de spécialité peut s’aborder sous l’angle statistique : en textométrie, et au niveau d’analyse d’une Œuvre entière, les basses fréquences (donc les formes rares) contribuent à construire les oppositions génériques et thématiques de ses composantes (Brunet, 2009). Dans le même temps, des formes lexicales particulièrement saillantes et caractéristiques d’un sous-corpus particulier sont susceptibles de ressortir avec la convocation de certaines méthodes : analyse factorielle des correspondances, calculs de spécificités, recherche de cooccurrences… sont autant de calculs pouvant réagir à la concentration de termes sur des empans de texte limités et à la relation qu’ils entretiennent avec d’autres formes de leur voisinage.
Avec cette présentation, nous appliquons l’outil textométrique à la question de la langue de spécialité afin de cartographier, à l’échelle d’un seul roman, l’évolution du personnage principal et tout en cherchant à superposer cette analyse à la structure de l’ouvrage.
Mots clefs
Langue de spécialité ; roman de formation ; roman historique ; textométrie
Références bibliographiques
Brunet, É. (2009). « Muller le lexicomaître ». In Delcourt, C., Hug, M. (éds.), Mélanges offerts à Charles Muller pour son centième anniversaire (22 septembre 2009). Paris : CILF, 99-119.
Durand-Le Guern, I. (2008). Le Roman historique. Paris : Armand Colin.
Moretti, F. (2019). Le roman de formation, traduction de l’italien par Camille Bloomfield et Pierre Musitelli. Paris : CNRS éditions. [Il romanzo di formazione, 1986]
Saxton, L. (2020). «A true story: defining accuracy and authenticity in historical fiction».
Oeuvre analysée
Bull-Hansen, B.-A. (2017). Jomsviking. Oslo: Gyldendal norsk forlag.
Julien DEGUELDRE
Université de Mons (Belgique)
Doit-on couler le drakkar ?
L’ère viking jouit indéniablement d’un grand intérêt de la part du public francophone. Les études, les ouvrages de vulgarisation, les œuvres littéraires, les jeux, les séries et les films, etc. portant sur cette période historique affluent, alors qu’une multitude de questions terminologiques sur divers termes spécifiques et realia relatifs à cette page de l’histoire abondent : Comment traduire les différents types d’habitation viking ? Quelle orthographe adoptée pour les dieux nordiques ? Quels mots utiliser pour les classes sociales de l’époque ?
Parmi cette multitude de thèmes, il en est qui agite particulièrement les flots : celui des bateaux et navires vikings. Grands navigateurs, les vikings ont révolutionné la technologie nautique de leur temps en développant de nouveaux procédés techniques et modèles d’embarcation, chacun portant évidemment un nom dans leur langue, le norrois. Mais comment à présent traduire ou transposer ces mots en français dans les nombreux cas où la langue de Molière ne possède pas d’équivalents ?
Via un emprunt au norrois ou aux langues scandinaves modernes ? Mais comment adapter ces mots aux règles grammaticales et orthographiques françaises ?
Le terme parapluie « drakkar », néologisme typiquement francophone, qui provoque souvent l’ire des spécialistes, est-il véritablement un si mauvais choix ? Et le cas échéant, quelles sont alors les autres options ?
Cette présentation aura pour but d’explorer quelques possibilités qui s’offrent à nous, en identifiant leur origine, leurs avantages, leurs inconvénients ou leurs limites, afin d’aider l’utilisateur francophone vers le choix terminologique le plus adéquat.
Références bibliographiques
Brillaud, B., & Brillaud, C. (Red.). (2023). Les vikings. Tallendier.
Malbos, L. (2024). Les peuples du Nord – De Fróði à Harald l’impitoyable. Belin.
Varberg, J. (2019). Viking – Ran, ild og sværd. Gyldendal.
Varberg, J. (Red.). (2021). Togtet – På rejse I vikingernes verden. Strandberg Publishing.
Lorenzo DEVILLA & Nicla MERCURIO
Université de Sassari (Italie)
Malts d’orge cara, houblons simcoe, dry hopping : les terminologies de la bière sur les RSN français et italiens entre expert∙e∙s et grand public
Le phénomène que Bach (2018) appelle la « numérisation de la dégustation » fait notamment référence aux activités se déroulant en ligne et aux initiatives promues sur les réseaux sociaux numériques (RSN) par certaines entreprises du secteur agroalimentaire. Ces entreprises informent ainsi la clientèle potentielle et la fidélisent, tout en vulgarisant un discours, généralement réservé aux spécialistes, afin d’attirer le grand public. Dans cette perspective, plusieurs recherches s’occupent de produits tels que le vin (Moutat 2018 ; Gautier 2020), l’huile d’olive (Janodet 2021 ; Le Guénanff 2024) et la bière artisanale (Konnelly 2020 ; Mercurio 2023), sur laquelle nous nous attarderons dans cette communication.
Les discours émanant du domaine brassicole, comme tout autre discours de dégustation, se caractérisent par une forte subjectivité et par la présence de « termes sensoriels », à savoir des termes désignant les descripteurs liés aux cinq sens qui ne sont ni univoques ni universels (Temmerman 2017: 136 ; Giboreau et al. 2007). Dans le contexte numérique, ces termes se mêlent à des « éléments technodiscursifs » comme les émojis et les hashtags (Paveau 2013a, 2013b, 2017), ainsi qu’à des termes désignant les styles de bière, les ingrédients, les équipements, les procédés et les techniques de production dont la signification peut échapper aux usager∙ère∙s.
En nous appuyant sur l’analyse du discours numérique et des RSN (Paveau 2013a, 2013b, 2017 ; Née 2017), nous nous focaliserons sur les terminologies de la bière présentes dans un corpus constitué de posts Facebook et Instagram, qui demeurent parmi les RSN les plus utilisés (Statista Research Department 2024), publiés par un échantillon de brasseries artisanales de régions françaises et italiennes. Nous identifierons également les pratiques de « vulgarisation » (procédés de reformulation, mécanismes métalinguistiques, etc.) qui simplifient les discours des spécialistes (Authier 1982 ; Jacobi 1987 ; Delavigne 2003 ; Conceição 2005 ; Vargas 2009) et rendent les terminologies accessibles aux néophytes. Par exemple, dans les deux langues, on trouve des explications sur les styles des bières (« Saison Grisette, la storica birra dei minatori belgi ») et sur les matières premières (« Le malt d’orge est la base de toute nos bières. Il va apporter le sucre pour donner le corps ainsi que l’énergie nécessaire aux levures pour travailler »), des technomots référés à la bière artisanale (#bièrelocale, #brasserietraditionnelle, #berebene), ainsi que des émojis reproduisant les ingrédients et des photos illustrant les étapes du brassage. Ces pratiques, qui bénéficient du caractère plurisémiotique des RSN, permettent aux moins expert∙e∙s de s’approprier les termes et les concepts du domaine brassicole, et de se rapprocher de l’univers de la bière artisanale.
Ainsi, nous confirmerons que les RSN, dont les entreprises de nombreux secteurs se servent souvent afin de promouvoir la marque, les biens et les services proposés en augmentant leur visibilité (FranceNum 2021 ; Knoll 2016 : 282), représentent un canal privilégie pour accéder aux langues de spécialité et en particulier aux terminologies d’un domaine donné, en tant que moyen de diffusion des connaissances spécialisées.
Mots clefs
Terminologie ; analyse des RSN ; discours numérique ; discours de dégustation ; bière artisanale
Références bibliographiques
Authier Jacqueline (1982), « La mise en scène de la communication dans des discours de vulgarisation scientifique », Langue française, 53(1), pp. 34-47.
Bach Matthieu (2018), Start-up du vin. Entre vrais apports et faux semblants, Paris, L’Harmattan.
Conceição Manuel Célio (2005), Concepts, termes et reformulations, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Delavigne Valérie (2003), « Quand le terme entre en vulgarisation », Conférence Terminologie et Intelligence artificielle, Strasbourg, pp. 80-91, https://hal.science/hal-00920636.
FranceNum (2021), « Quel réseau social choisir pour développer son entreprise ? », https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/communication-et-publicite/reseaux-sociaux/quel-reseau-social-choisir-pour.
Gautier Laurent (2020), « Initier à la dégustation ou… enseigner une terminologie de dégustation ? Les termes de la dégustation dans les outils en ligne », Stengel Kilien (éd.), Terminologies gastronomiques et œnologiques. Aspects patrimoniaux et culturels, Paris, L’Harmattan, pp. 137-156.
Giboreau Agnès, Dacremont Catherine, Egoroff Carine, Guerrand Sylvie, Urdapilleta Isabel, Candel Danielle, Dubois Danièle (2007), « Defining Sensory Descriptors: Towards Writing Guidelines Based on Terminology », Food Quality and Preference, 18(2), pp. 265-274.
Jacobi Daniel (1987), Textes et images de la vulgarisation scientifique, Berne, Peter Lang.
Janodet Francisco Luque (2021), « La métaphore conceptuelle dans les langues de spécialité : enjeux terminologiques et linguistiques de son emploi dans l’analyse organoleptique de l’huile d’olive (français-espagnol) », Synergies Europe, 16, pp. 129-143.
Knoll Johannes (2016), « Advertising in Social Media: A Review of Empirical Evidence », International Journal of Advertising, 35(2), pp. 266-300.
Konnelly Lex (2020), « Brutoglossia: Democracy, Authenticity, and the Enregisterment of Connoisseurship in “Craft Beer Talk” », Language & Communication, 75, pp. 69-82.
Le Guénanff Guylaine (2024), « Étude comparative de la mise en récit de l’huile d’olive en Provence et en Toscane », Colloque international Local, authentique, durable : la gastronomie face à la globalisation. Perspectives multidisciplinaires, Université de Sassari 7-8 octobre 2024.
Mercurio Nicla (2023), « La bière à l’heure de l’évaluation participative : terminologies et pratiques discursives dans les avis de consommateurs en ligne », in Fadda, Saggiomo (éd.), Un coup de dés, 11, Paris, La Renaissance française, pp. 183-194.
Audrey Moutat (2018), « Discours transgressifs des vins naturels », La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 166, pp. 9-11.
Née Émilie (2017), Méthodes et outils informatiques pour l’analyse des discours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Paveau Marie-Anne (2013a), « Genre de discours et technologie discursive », Pratiques, 157-158, http://journals.openedition.org/pratiques/3533.
Paveau Marie-Anne (2013b), « Technodiscursivités natives sur Twitter. Une écologie du discours numérique », Epistémé, 9, pp. 139-176.
Paveau Marie-Anne (2017), L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, Paris, Hermann.
Statista Research Department (2024), Classement des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde en janvier 2024, selon le nombre d’utilisateurs actifs (en millions), https://fr.statista.com/statistiques/570930/reseaux-sociaux-mondiaux-classes-par-nombre-d-utilisateurs.
Temmerman Rita (2017), « Verbalizing Sensory Experience for Marketing Success. The Case of the Wine Descriptor Minerality and the Product Name Smoothie », in Temmerman, Dubois, Food Terminology. Expressing Sensory Experience in Several Languages, Philadelphia, John Benjamins, pp. 132-154.
Vargas Elodie (2009), « Discours de vulgarisation à travers différents médias ou les tribulations des termes scientifiques. Le cas de la médecine », ILCEA, 11, https://journals.openedition.org/ilcea/217.
Mustapha KHIRI & Lamya CHOUKY
Université Moulay Ismail (Maroc)
Le processus de vulgarisation du français médical sur les réseaux sociaux : la métaphore dans la langue médicale pédiatrique populaire au Maroc
Cette contribution vise à examiner l’utilisation de la métaphore en tant qu’outil de vulgarisation du français médical dans les discours des experts en santé diffusés sur les réseaux sociaux. L’analyse se fonde sur des exemples concrets et sur la perception du grand public, en particulier les parents en quête d’informations pédiatriques, qui s’expriment dans un langage populaire marocain.
Dans le contexte marocain, la vulgarisation de la langue médicale spécialisée apparaît comme une nécessité incontournable. En effet, la formation des médecins dans les facultés de médecine se fait en français spécialisé, tandis que les échanges avec la population marocaine s’effectuent principalement en arabe ou en amazighe, langues de communication quotidienne chez la plupart des Marocains.
Dans cette perspective de vulgarisation des savoirs médicaux, de nombreux médecins ont recours aux réseaux sociaux pour rendre l’information médicale accessible à un public non spécialisé. L’usage de la métaphore joue un rôle central dans ce processus, en permettant de simplifier des concepts médicaux complexes, les rendant ainsi plus compréhensibles, plus concrets et accessibles pour un public non expert.
Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour une approche méthodologique mixte. Premièrement, une analyse qualitative de la langue médicale pédiatrique a été menée sur un échantillon de vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans lesquelles des médecins en particulier des pédiatres emploient des métaphores pour expliquer des concepts médicaux complexes. Deuxièmement, une enquête par questionnaire a été réalisée. Elle a ciblé, d’une part, des médecins créateurs de contenu médical pédiatrique afin de comprendre leurs motivations quant à l’usage de la métaphore dans la vulgarisation, et d’autre part, des parents pour évaluer leur compréhension et perception des métaphores médicales.
Les résultats de cette étude montrent que l’usage de la métaphore est fréquent dans les discours des experts médicaux. Ces métaphores sont de différents types et prennent diverses formes grammaticales, notamment nominales, verbales et adjectivales. Elles s’inscrivent dans des motifs sociolinguistiques liés à la culture partagée, dans lesquels l’expert s’éloigne du champ médical pour mobiliser des représentations issues des domaines social et culturel.
Mots clefs
Vulgarisation ; français médical pédiatrique ; métaphore ; langue populaire marocaine ; réseaux sociaux
Natascia LEONARDI
University of Macerata (Italy)
How it came about that humans think that Martians may exist
The communication of scientific matters and the complex issues related to it have a long and complex history. We focus here on a specific case from the period between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. It started with the identification of so-called ‘canals’ on the planet Mars via telescopic observation to the diffusion of the idea that Martians inhabited the planet.
This event is considered as a trigger for a more general speculation on scientific communication at different levels, depending on the sender, the receiver, and the use of different media. In the present work the discussion concerns astronomy and the way it was communicated to both specialists and non-specialists, in particular by astronomers – the Italian Giovanni Virgilio Schiaparelli (1835-1910), the American Percival Lowell (1855-1916), and the Frenchman Nicolas Camille Flammarion (1842-1925).
This analysis originates from the curious and well-known case of the (presumably intentional) mistranslation of a term from Italian into English. The term is ‘canale/i’ and the translation given is ‘canal/-s’ instead of ‘channel/-s’. The author of the original texts – and observation – was Schiaparelli, widely known especially for his telescopic observations of the planet Mars. The international dissemination of this mistranslation in popular publications ushered in a series of events which took shape in the collective imagination in the form of Martians. These events favoured the popular spread of the belief in the presence of living beings on planets other than the Earth.
Orson Welles radio drama (1938) adapted from H.G. Wells The War of the Worlds (1898) about a Martian invasion caused collective panic by convincing the lay audience that this invasion was actually taking place in real time, lending credence to the existence of these extraterrestrial beings.
In this study ‘popularization’ refers to the diffusion of information to the lay public or to experts of other fields who might be interested in the subject. This type of communication may also have educational purposes, oriented either to students or young or less educated people. Popularization aims at bridging the knowledge gap between the specialist and the layperson (Bucher 2019: 59), and can do it at different levels of simplification and adaptation depending on the contexts and media used (cf. Casamiglia/Van Dijk 2004; Kastberg 2014: 37; van Dijk 2014: 104-107).
This analysis consists in a preliminary identification of the type of communication instantiated by the authors here under exam. The specific characteristics of their texts partly relate to the type of ‘receivers’, or public who read their writings, the context in which communication took place, and the media used. It is possible to observe cases of deliberate concealing and deliberate omission of actual scientific information, together with variations that the authors also used in order to ‘adapt’ to the specific receivers they had identified for their texts.
Mots clefs
Scientific communication ; popularization ; terminology ; scientific text ; canals
Références bibliographiques
Bucher, Hans-Jürgen 2019. “The contribution of media studies to the understanding of science communication”. In Annette Leßmöllmann et al. (eds.) Science Communication. Boston/Berlin: De Gruyter Mouton. 2019: 51-76.
Calsamiglia, Helena, and van Dijk, Teun A. 2004. “Popularization discourse and knowledge about the genome”. Discourse and Society, 15/4: 369-389.
Flammarion, Camille 1892. La planète Mars et ses conditions d’habitabilité. Paris: Gauthier-Villars.
Kastberg, Peter 2014. “Languages for special purposes as instruments for communicating knowledge”. In John Humbley, Gerhard Budin and Christer Laurén (eds.) Languages for Special Purposes: An International Handbook. Boston/Berlin. De Gruyter Mouton: 26-44.
Lowell, Percival 1906. Mars and Its Canals. New York: The Macmillan Company.
Schiaparelli, Giovanni Virginio 1894. “The Planet Mars” trans. W.H. Pickering, Astronomy and Astrophysics, 13/9 (1894): 635-39.
Schiaparelli, Giovanni Virginio 1898. “La vie sur la planète Mars”. Société astronomique de France bulletin 12: 423-429. [Orig. “La vita sul pianeta Marte”. Natura e Arte. 1895]
van Dijk, Teun A. 2014. Discourse and Knowledge. A Sociocognitive Approach. Cambridge. Cambridge University Press.
Wells, Herbert G. 1898. The War of the worlds. London. William Heinemann.
Laura MARTIN-GOMEZ
Université Toulouse III – Paul Sabatier (France)
De la science en fantasy : lectures scientifiques de l’œuvre de Tolkien
Au sein des littératures de l’imaginaire, la science-fiction est le genre que l’on associe le plus spontanément aux sciences et à la technologie. Cela est beaucoup moins vrai pour la fantasy, genre principalement associé aux mythes, à la magie ou à l’histoire. Pourtant, des liens indéniables, quoiqu’encore peu explorés, existent entre les sciences et l’œuvre fictionnelle de J.R.R. Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux (1954-55). Ce roman, souvent considéré comme fondateur pour la fantasy contemporaine, se déroule dans l’univers fictionnel de la Terre du Milieu, aujourd’hui devenu transmédiatique et incontournable dans la culture populaire dite « geek ».
En avril 1956, de nombreux fans avaient déjà écrit à l’auteur en témoignant de leur intérêt pour les aspects fictionnels liés à leur activité professionnelle : « Les musiciens veulent des mélodies et une notation musicale ; les archéologues veulent des précisions sur la céramique et la métallurgie. Les botanistes veulent une description plus précise des mallorn, elanor, niphredil, alfirin, mallos et symbelmynë ; et les historiens veulent davantage de détails sur la structure sociale et politique du Gondor » (J.R.R. Tolkien, XXX). Chez certains fans, cette « pulsion de complétude » (Anne Besson, 2004) à « coloration » professionnelle s’associe parfois à une lecture de l’œuvre au prisme de leur expertise scientifique, quelle qu’elle soit.
Nous nous proposons d’étudier la manière dont des fans de Tolkien, scientifiques de profession, appliquent leur domaine de spécialité à l’univers de la Terre du Milieu. Il s’agit d’observer comment la vulgarisation scientifique, mise en place par ces fans, s’articule avec la réception de l’œuvre littéraire dans son ensemble. Dans quelle mesure le regard scientifique éclaire-t-il l’œuvre littéraire ? À l’inverse, l’œuvre a-t-elle une véritable valeur scientifique ? Peut-on parler d’un discours spécialisé scientifique appliqué à l’œuvre de Tolkien ? Enfin, comment ces textes, à la croisée de plusieurs disciplines, sont-ils accueillis au sein des communautés de fans et par les scientifiques ?
Après avoir rappelé dans les grandes lignes l’histoire de la réception de l’œuvre de Tolkien, qui témoigne d’un entrelacement entre celle-ci, les sciences et les communautés de fans, nous restreindrons volontairement ce vaste sujet à une étude de deux ouvrages, Tolkien et les sciences (2019) et The Science of Middle-earth (2004), ainsi qu’à leurs critiques respectives rédigées par des fans et des scientifiques. Ce corpus limité nous permettra d’analyser au plus près les marqueurs discursifs pour déterminer l’existence ou non d’un discours spécialisé, ainsi que les modalités d’insertion (ou non) de ces excursions scientifiques au sein de la réception plus globale de l’œuvre littéraire de Tolkien.
Mots clefs
Tolkien ; fandom ; réception ; vulgarisation ; sciences
Références bibliographiques
Besson, A. (2004). D’Asimov à Tolkien : Cycles et séries dans la littérature de genre. CNRS Éditions.
Gee, H. (2004). The Science of Middle-earth. Cold Spring Press.
Lehoucq, R., Steyer, J-S., Mangin, L. (dir.). (2019). Tolkien et les sciences. Belin.
Martin-Gomez, L. (2020). « La réception de l’œuvre de Tolkien par ses fans » [thèse de doctorat en littérature comparée]. Arras.
Peyron, D. (2013). Culture geek. Limoges : Fyp Éditions.
Tolkien, J.R.R., Carpenter, H. (éd.). (1981, trad. 2005). Lettres. Paris : Christian Bourgois.
Andrew McMURRY
University of Waterloo (Canada)
Science Communication from the Dead to the Living: Zombie Discourse and Vaccine Skepticism
With its roots in the Gothic romance, the horror genre has reliably offered an anti-Whiggish view of scientific progress, with arrogant scientists and unscrupulous technologists generating the conditions for individual or collective catastrophe. In Mary Shelley’s Frankenstein, Victor provides the ur-script for the scientist playing at God. The horror sub-genre of the zombie has been particularly fixated on this theme, even as it has been extended to critique mode variety of other social and political issues. In the wake of George Romero’s revision of the classic voodoo zombie in his Night of the Living Dead (1968)—creating what philosopher David Chalmers calls “the Hollywood form”— the zombie has provided metaphoric support for the critique of: class (Land of the Dead, 2005); suburban anomie (Black Summer, 2019-21); settler-colonialism (Blood Quantum, 2019); consumerism (Dawn of the Dead, 1978); and foreign invasion (Kingdom, 2019-21).
Yet the crucial motif of “science gone wrong” is never very far from any of these books, films, and tv series. That’s because the origin of the zombie outbreak is rarely supernatural or eschatological; it is secular in origin, emerging from the wet markets, the bioweapons facilities, the genomic and viral research labs, and simply when pathogens secreted deep in the jungle are introduced to unwitting urban populations by naive field biologists. A zombies, to put it plainly, is nature biting back at modernity.
The felicity of the zombie narrative is revealed in the massive uptake of the zombie-as-metaphor in a host of science and social science fields, everything from ground water studies to ophthalmology to international relations. But it’s clear that in its “Hollywood form” the zombie is primarily in the business of escapism and catharsis. The notional underlying science of zombie infections—such as there is any science at all—is typically delivered in technobabble and pseudoscientific phrasemaking. Nevertheless there is often a methodological rigour of sorts in the texts, in that while the social and personal consequences of the zombie outbreak are paramount, a frequent plot driver will be the search for a cure. In other words, the zombie narrative models the real world dialectics of techno-failure and techno-fix, and like any popular cultural form contributes, however indirectly, to shaping public perceptions and understandings.
Using a discourse analytical approach, I look at the suasory features that indict the poor science that causes the zombie apocalypse alongside those features that champion the sounder science that (futilely) aims to prevent it. How does the LSP of the zombie genre—via jargon, narratological events, processes, and imagery—inform/effect/cultivate audience perceptions about fictional zombie pathogenesis and by extension pathogenesis in the real world? Most searchingly, are there any connections to be made between vaccine skepticism/ hesitancy/anti-vax conspiracy theory and the semiotics of blood and brain infection essential to the zombie corpus? While mine is not a reception study, in this paper I will corollate data across a wide sample of zombie narratives, and speculate about the rhetorical impact of this horror sub- genre that for the last 40 years and more has saturated the popular imagination with visions of modern technoscience irresponsibly producing and then failing to contain its blood-borne contagions.
Mots clefs
Biohorror ; rhetoric ; pandemic discourse, film, literature
Références bibliographiques
Cooke, Jennifer. Legacies of Plague in Literature, Theory and Film. New York: Palgrave MacMillan, 2009.
Drezner, Daniel. Theories of International Politics and Zombies. Princeton: Princeton UP, 2011.
Khan, Ali S. “Preparedness 101: Zombie Apocalypse”. Office of Public Health Preparedness and Response. Public Health Matters Blog. Centers for Disease Control and Prevention. Archived from the original on June 12, 2011.
Lauro, Sarah Juliet. Zombie Theory: A Reader. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.
Mamalis, Nick, “Zombie issues in ophthalmology.”Journal of Cataract & Refractive Surgery. September 2017, Volume 43 (Issue9). 1127- 1128.
Petretto, Cecilia. “Attack of the Living Dead Virus: The Metaphor of Contagious Disease in Zombie Movies.” Journal of the Fantastic in the Arts, Vol. 17, No. 1 (65) (Spring 2006), pp. 21-32.
Reis Filho, Lúcio. “Live and Let Die…Necropolitics and Zombie Film Tropes During the COVID-19 Pandemic.” Extrapolation, vol. 63, no. 1 (2022)
Schwartz, Franklin. “Zombie-Science and Beyond.” Ground Water, Vol. 51, No. 1. (January-February 2013).
Camilla NAPPI
Université de Naples « L’Orientale » (Italie)
La culture populaire à l’ère numérique : analyse des discours de vulgarisation de l’art sur Instagram
Les réseaux sociaux et les technologies numériques jouent un rôle déterminant dans la diffusion et la promotion de la culture populaire, en transformant profondément les modes de création, de partage et de consommation des contenus culturels (Lalo, 2018). Ces plateformes facilitent une circulation rapide et virale des contenus, tout en rassemblant des communautés autour de multiples intérêts communs.
Les mèmes Internet illustrent bien cette dynamique : souvent inspirés du cinéma, de la musique, des jeux vidéo ou de l’actualité, ils réinterprètent des moments et des idées précis avec humour ou satire, et deviennent pourtant des marqueurs significatifs de la culture populaire (Wagener, 2022 ; Simon & Wagener, 2024). Par ailleurs, ils offrent également une forme d’expression collective qui reflète les tendances et préoccupations actuelles.
Notre proposition de communication a pour objectif d’examiner l’interaction complexe entre culture populaire et nouvelles technologies à travers l’étude des discours numériques dédiés à la vulgarisation de l’art sur Instagram. Plus particulièrement, nous nous intéressons à la manière dont les créateurs de contenu exploitent des références issues de la culture populaire – notamment par le biais des mèmes – pour capter l’attention du public et rendre l’art plus accessible. La culture populaire se révèle ainsi un outil stratégique dans la transmission des savoirs artistiques.
Notre étude s’appuie sur une approche « technodiscursive » inspirée de l’analyse du discours numérique natif (Paveau, 2017 : 8). Cette perspective dépasse l’analyse purement linguistique pour inclure les dimensions sociale, culturelle, historique, politique et technologique qui façonnent les discours. À cette fin, nous explorons un corpus constitué des contenus de deux comptes Instagram influents dans la vulgarisation de l’art, à savoir : @la.minute.culture et @ohpet.art. Ces pages ont été sélectionnées en raison de leur capacité à combiner une esthétique visuelle soignée, des contenus pédagogiques accessibles, et une exploitation stratégique des références issues de culture populaire. Nous souhaitons donc mettre en lumière la performativité des outils de communication proposés par Instagram dans la diffusion de la culture populaire, ainsi qu’analyser les spécificités des discours de vulgarisation artistique sur ce réseau, en insistant sur leur nature plurisémiotique et technodiscursive (Paveau, 2013, 2015, 2019 ; Longhi & Vicari, 2020). Cette étude vise également à souligner la place de la langue de spécialité de l’art dans les discours numériques des comptes pris en examen.
Une attention particulière sera, entre autres, portée à l’usage des mèmes en tant que « technographismes » (Paveau, 2017, 2019) privilégiés dans les stratégies discursives employées pour la vulgarisation artistique sur Instagram. L’objectif est donc d’éclairer la manière dont les références à la culture populaire contribuent à l’engagement du public et favorisent la diffusion des connaissances artistiques via les réseaux sociaux.
Mots clefs
Culture populaire ; discours numériques natifs ; mèmes ; vulgarisation artistique ; Instagram
Références bibliographiques
Paveau M.-A., « Ce qui s’écrit dans les univers numériques », in Itinéraires, n. 2014-1, janvier 2015, http://journals.openedition.org/itineraires/2313, dernière consultation le 06/08/2024.
Paveau M.-A., « Technodiscursivités natives sur Twitter. Une écologie du discours numérique », in Epistémè, n. 9, 2013, pp.139-176, https://inria.hal.science/hal-00859064/, dernière consultation le 06/08/2024.
Paveau M.-A., « Technographismes en ligne. Énonciation matérielle visuelle et iconisation du texte », in Corela, n. 28, 2019, http://journals.openedition.org/corela/9185, dernière consultation le 06/08/2024.
Paveau M.-A., L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, Hermann, Paris, 2017.
Longhi J., Vicari S., « Présentation du numéro », Repères-Dorif, n. 22 – Corpus réseaux sociaux, analyse du discours, DoRiF Università, Roma, octobre 2020, https://www.dorif.it/reperes/presentation-du-numero-julien-longhi-stefano-vicari/, dernière consultation le 06/08/2024.
Lalo V., « Le numérique, une culture populaire », in Revue Résonnances, n. 25, octobre 2018, https://vanessalalo.com/article-le-numerique-une-culture-populaire-revue-resonnances/, dernière consultation le 06/08/2024.
Wagener A., Mèmologie : théorie postdigitale des mèmes, Grenoble, UGA Éditions, 2022.
Simon J., Wagener A., « Mèmes », in Publictionnaire, juin 2024, https://publictionnaire.huma-num.fr/notice/memes, dernière consultation le 06/08/2024.
Vanessa PAOLI
Università degli studi internazionali (UNINT) de Rome (Italie)
La langue juridique dans les romans de Gianrico Carofiglio
Magistrat, écrivain, professeur : avec ses romans traduits dans plus de trente langues (Colasanti, 2022), Gianrico Carofiglio ne nécessite pas de longues présentations. L’union de son expertise juridique et de son talent littéraire permet d’obtenir des ouvrages uniques en leur genre. Avec son œuvre Con parole precise (2015), nous comprenons déjà l’attention de l’auteur vers le choix linguistique, où il nous rappelle que « la democrazia vive di parole precise » (litt., « la démocratie vit des mots précis »). En effet, grâce à la lecture de ses livres les plus célèbres, nous pouvons saisir l’importance de la terminologie qui nous contextualise dans un secteur spécifique : le domaine juridique. Toutefois, en raison de la typologie du moyen, le roman, le lecteur ne ressent pas ce poids terminologique que nous venons de mentionner. Le texte résulte extrêmement clair, compréhensible, voire – en reprenant la notion de clarté offerte par Gémar (2018) – lisible et intelligible. Nous savons également que la maîtrise des notions juridiques et linguistiques ne va pas de soi, notamment en traduction où parfois il n’y a pas de correspondances univoques, car le droit, comme la langue, est l’expression d’une culture (Gémar, 2011) et la culture appartient à son peuple. Toutes ces réflexions provoquent une vraie quête entre équivalence normative et équivalence terminologique (Gémar, 2001), voire la recherche d’une équivalence fonctionnelle (Pigeon, 1982), auxquelles s’ajoute une autre grande difficulté pour tout(e) apprenant(e) allophone de la langue juridique, c’est-à-dire les collocations (Dechamps, 2004), un élément qui est également incontournable en phase de traduction (Giráldez Ceballos-Escalera, 2010). Une telle perspective pourrait enfin décourager les étudiants à se lancer dans ce type d’étude et de parcours à la fois académiques et professionnels, car il ne s’agit pas seulement de « transcoder des etiquettes » (Lerat, 2002) mais de « rendre l’âme » (Serrano Lucas, 2011) du texte de spécialité à traduire. À ce point, il est clair que la présence de romans de fiction, écrits par un auteur présentant également les connaissances d’un magistrat, constitue une richesse incomparable, notamment lorsque ces mêmes récits ont été traduits en plusieurs langues. Dans notre étude, à partir du secteur de la juritraductologie (Monjean-Decaudin, 2022), nous proposons l’analyse de certains extraits des romans de Gianrico Carofiglio, en comparant la version italienne et la version française, afin d’en obtenir une vue d’ensemble sur la terminologie la plus fréquente et un point de repère pour un apprentissage linguistique capable d’unir le plaisir pour la lecture et l’attention lexicale, en restant bien conscients des stratégies traductives (p.ex. sourcières ou ciblistes) appliquées. En effet, notre approche sera à la fois quantitative et qualitative, car – en analysant les cooccurrences, nous n’obtenons pas seulement « un saut quantitatif mais [également] une rupture qualitative » (Mayaffre, 2007). Nous le savons bien : ignorantia legis non excusat, « nul n’est censé ignorer la loi », ce qui vaut même pour le traducteur et pour tout(e) étudiant(e) de jurilinguistique.
Mots clefs
Jurilinguistique ; traduction ; littérature, français, italien
Références bibliographiques
CAROFIGLIO, G. (2015). Con parole precise. Breviario di scrittura civile, Laterza.
COLASANTI, V. (2022). « A casa di Carofiglio: le palline da giocoliere, i quadri del fratello e il monopattino pronto per uscire », La Repubblica, en ligne. https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/06/15/news/casa_gianrico_carofiglio-354021239/#:~:text=Per%20uno%20scrittore%20come%20lui,portavo%20le%20pratiche%20dall’ufficio. Consulté le 7 octobre 2024.
DECHAMPS, C. (2004). « Enseignement/apprentissage des collocations d’une langue de spécialité à un public allophone : l’exemple de la langue juridique », Éla. Études de linguistique appliquée, vol. 3, n°135, pp. 361-370. https://doi.org/10.3917/ela.135.0361. Consulté le 5 octobre 2024.
GÉMAR, J.-C. (2001). « Langage du droit et traduction enjeux, difficultés et nuances de la traduction juridique », Droit et langues étrangères 2, Elsa Matzner (éd.), Presses universitaires de Perpignan. https://doi.org/10.4000/books.pupvd.26709. Consulté le 10 octobre 2024.
GÉMAR, J.-C. (2011). « Aux sources de la “jurilinguistique” : texte juridique, langues et cultures », Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI, p. 9-16. https://doi.org/10.3917/rfla.161.0009. Consulté le 30 octobre 2024.
GÉMAR, J.-C. (2018). « Analyse jurilinguistique des concepts de « lisibilité » et d’« intelligibilité » de la loi », Revue générale de droit, vol. 48, no 2. https://doi.org/10.7202/1058624ar.
GIRÁLDEZ CEBALLOS-ESCALERA, J. (2010). « La combinatoire collocationnelle dans le discours juridique : élément indispensable dans l’aide à la traduction », La traduction juridique – points de vue didactiques et linguistiques, Lyon 3. Lien : http://www.initerm.net/public/langues%20de%20sp%C3%A9cialit%C3%A9/colloque/Joaqu_n_Gir_ldez.pdf . Consulté le 26 juin 2024.
LERAT, P. (2002). « Qu’est-ce qu’un verbe spécialisé ? Le cas du droit », Cahiers de lexicologie, vol. 80, no 1, pp. 201-211.
MAYAFFRE, D. (2007). « L’entrelacement lexical des textes. Co-occurrences et lexicométrie », Journées de Linguistique de Corpus, Lorient, pp. 91-102.
MONJEAN-DECAUDIN, S. (2022). Traité de juritraductologie. Épistémologie et méthodologie de la traduction juridique, Presses Universitaires du Septentrion.
PIGEON, L.-P. (1982). « La traduction juridique. L’équivalence fonctionnelle », Langage du droit et traduction. Essais de jurilinguistiques, J.-C. Gémar (éd.), Québec, Conseil de la langue française, pp.271-281.
SERRANO LUCAS, L. C. (2011). « Rendre un jugement sans “rendre l’âme”: l’importance des collocations spécialisées dans l’enseignement du français juridique », Filología Francesa, no 19, 2011, pp. 287-301. Lien : https://revistas.um.es/analesff/article/view/155661/136741. Consulté le 15 octobre 2024.
Raffaele PIZZO
Università degli Studi di Napoli « Parthenope » (Italie)
The Popularisation of the Language of Chemistry: The Use of LSP in Online Cosmetics Advertising
Languages for Specific Purposes (LSP) function as essential communicative tools, facilitating the transmission of specialised knowledge across diverse fields (see Swales, 2000). Although traditionally associated with technical and scientific communities, LSP has also permeated popular culture, including literature, cinema, television, and social media (see Barashkova et al., 2019; Solomentsev et al., 2016). This study draws on examples such as The Big Bang Theory, Interstellar, and Disney’s Donald in Mathmagic Land (see the International Conference Languages for Specific Purposes and the Popularization of Science in Pop Culture, CfP) to analyse how technical terminology and scientific concepts are integrated into online platforms targeting a broader audience. It posits that such media forms act as cultural artifacts (Johns, 1994: 4), serving as a bridge between expert communities and the general public, thereby rendering scientific discourse more accessible and engaging.
The present study focuses specifically on the language used in social media through a diachronic analysis of the specialised language of chemistry, which has become increasingly prevalent in descriptions of cosmetic products in recent years (see Ringrow, 2024; 2016b). Chemical ingredients such as niacinamide, salicylic acid, and retinol, once found exclusively in the INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients—a standardised list of ingredient names used in cosmetics and personal care products), are now widely used in social media advertisements and product packaging to enhance consumer appeal and drive sales (see Arjulayana & Enawar, 2022; Bai, 2018; Ringrow, 2016a).
This research is grounded in two key assumptions: while general language is more easily comprehensible to consumers, cosmetics companies have increasingly favoured specialised language in their social media marketing. Whereas older advertisements (for skincare and beauty products) tended to employ emphatic, persuasive, and catchy general language (see Goddard, 2002), recent advertisements are characterised by a significant use of LSP terminology (see Ringrow 2014; 2016b), resulting in more complex and less accessible messages. Despite this complexity, the cosmetics industry’s sales figures have consistently increased in recent years, with the only exception being the temporary decline during the COVID-19 pandemic.
To investigate the socioeconomic mechanisms driving this linguistic shift, this study analyses a corpus of recent social media posts from prominent English cosmetics companies (e.g., Charlotte Tilbury, Byoma, The Inkey List) alongside older advertising campaigns. The temporal scope of the study spans the twenty-first century; while the recent social media posts date to 2024, the historical advertising campaigns extend back to the 2000s and beyond. This research employs a diachronic and qualitative methodology to achieve its objectives and address the research questions.
By providing linguistic data on the shift from general language to specialised terminology, the current analysis aims to offer possible explanations for this linguistic phenomenon and reveal its underlying socioeconomic factors.
Mots clefs
LSP ; popularisation; the language of chemistry; cosmetics advertising; social media
Références bibliographiques
Arjulayana, A., & Enawar, E. (2022). Cosmetics Advertisement Language through Discursive Psychology. Linguists: Journal Of Linguistics and Language Teaching, 8(2), 205-215.
Bai, Z. (2018). The characteristics of language in cosmetic advertisements. Theory and Practice in Language Studies, 8(7), 841-847.
Barashkova, A. L., Vorob’ev, I. V., Shavaev, A. A., & Zapolskaya, A. N. (2019, September). New Methods of Science Popularization in the Social Media: Modern Trends and Communications. In 2019 International Conference “Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies” (IT&QM&IS) (pp. 463-465). IEEE.
Goddard, A. (2002). The language of advertising: written texts. Psychology Press.
Johns, A. M. (1994). LSP and culture: A special relationship. ASp, 56, 1119. https://doi.org/10.4000/asp.4002.
Ringrow, H. (2014). Peptides, proteins and peeling active ingredients: exploring ‘scientific’ language in English and French cosmetics advertising. Études de stylistique anglaise, (7), 183-210.
Ringrow, H. (2016a). The language of cosmetics advertising. Springer.
Ringrow, H., & Ringrow, H. (2016b). Scientised Beauty Advertising Discourse: With Peptides or Paraben-Free?. The Language of Cosmetics Advertising, 81-104.
Solomentsev, Y. M., Sheptunov, S. A., Karlova, T. V., Barashkova, A. L., Vorobjev, I. V., Zapolskaya, A. N., … & Glashev, R. M. (2016, October). Popularization of science in online media: Theory and practice. In 2016 IEEE Conference on Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies (IT&MQ&IS). Proceedings.-M.: Fond «Kachestvo» (pp. 163-167).
Swales, J. M. (2000). Languages for specific purposes. Annual review of applied linguistics, 20, 59-76.
Joëlle POPINEAU
Université de Tours (France)
Dissémination juridique dans les séries juridico-criminelles américaines et britanniques. Vers une exploration terminologique des transcriptions
Cette étude s’inscrit dans l’étude des fictions à substrat professionnel (FASP) (Petit 1999, Isani 2010) et porte sur les transcriptions de plusieurs épisodes de séries juridico-criminelles (ou legal drama) anglo-saxonnes. Les transcriptions étudiées sont issues d’épisodes de deux legal drama américaines, Bull (série diffusée entre 2016-2022) et The Lincoln Laywer (série diffusée entre 2022 et 2024) et d’une série policière britannique, Life on Mars (série diffusée en 2006 et 2007).
Souvent co-écrits avec l’aide de conseillers juridiques ou d’avocats, les scénarios dressent un panorama fidèle du fonctionnement judiciaire du pays de common law concerné et utilisent une langue de spécialité qui par le biais d’enquêtes ou de plaidoiries, d’interrogatoires ou de procès, dissémine la langue du monde juridique ou jurilectes (Popineau 2021) dans le monde des téléspectateurs.
L’objectif premier de la fiction est le divertissement, mais un deuxième objectif apparaît : celui de « présenter, ou plutôt de représenter, les pratiques professionnelles, culturelles et langagières propres à certains milieux professionnels, en les rendant effectivement présentes à la vue et à l’esprit des téléspectateurs » (Cartron 2022).
Outre ses deux objectifs, un troisième objectif – terminologique et didactique - est mis en lumière dans notre étude : l’utilisation du logiciel de textométrie TXM permet l’extraction du lexique et un repérage des phraséologies juridiques (exemple (1) :
- Innocent until proven guilty.
Innocent till proven guilty?
The burden is on the government. To prove that you’re guilty. Beyond a reasonable doubt. (Bull, saison 1, épisode 1).
ou des jurilectes (exemples (2) et (3) :
The defendant will be notified his arraignment, informing of charges against him (Bull, saison 3, épisode 5).
We got a call from Judge Holder. She wants to meet with you ASAP.
The Chief Judge?
Technically, the presiding judge.
[…] Your Honor (The Lincoln Lawyer, saison 1, épisode 1)
ou de leurs occurrences et cooccurrences, voire de leur contextualisation législative (exemple 4) :
- Colin Raimes? Open the door, please! Police! Mr Raimes, we have a warrant
to search the house and remove property in compliance with the Criminal Evidence Act. (Life on Mars, saison 1, épisode 1)
Cinq stratégies de dissémination des jurilectes sont identifiées : ces termes opaques pour le téléspectateur à leur première occurrence s’entourent de procédés aidant à leur compréhension tels l’explication du concept juridique (1), la définition (2 et 4), la chaîne synonymique (3), la reformulation (1 et 3) et la référence législative (4) ; une fois la phraséologie ou le jurilecte identifié, il est repris dans la narration.
Cette communication s’appuiera sur des exemples de transcriptions et proposera une classification des procédés de dissémination des jurilectes en fonction de leur degré de juridicité (Monjean-Decaudin, 2022) ; le degré de juridicité représente la quantité d’informations juridiques requises à la compréhension d’un terme. Nous verrons ainsi la corrélation entre degré de juridicité élevé et nombre élevé de procédés mis en œuvre, illustrant le dessein didactique des séries.
Mots clefs
Dissémination juridique ; transcription de séries télévisuelles ; textométrie ; terminologie
Références bibliographiques
Cartron, Audrey. (2021) « Vers une caractérisation du spécialisé représenté dans la fiction à substrat professionnel télévisuelle : l’exemple de la série policière et criminalistique NCIS », ILCEA [En ligne], 47 | 2022, mis en ligne le 01 juin 2022, consulté le 30 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ilcea/15239 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ilcea.15239
Heiden, S., Mague J.- & Pincemin B. (2010). « TXM : Une plateforme logicielle open-source pour la textométrie – conception et développement ». JADT 2010: 10th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data. Italie: Rome. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/97/79/PDF/Heiden_al_jadt2010.pdf
Monjean-Decaudin, Sylvie. (2022). Traité de juritraductologie. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion.
Popineau, Joëlle. (2021). « Traduire les technolectes juridiques ou jurilectes dans la presse anglaise et française – approche juritraductologique et terminologique » Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, Vol. 66 (2), p. 427-450.
Petit, Michel (1999). « La fiction à substrat professionnel : une autre voie d’accès à l’anglais de spécialité », ASp (23-26), 57-81, https://doi.org/10.4000/asp.2325. DOI : 10.4000/asp.2325
Isani, Shaeda . (2010a), « Quand la science enquête : imaginaires & représentations de la FASP criminalistique », ILCEA (12), http://journals.openedition.org/ilcea/583. DOI : 10.4000/ilcea.583
Références des séries télévisuelles étudiées
Life on Mars est une série britannique policière diffusée sur BBC1 entre le 9 janvier 2006 et le 10 avril 2007 ; la première saison est suivie d’une seconde saison, Ashes to Ashes.
The Lincoln Lawyer est une série juridico-criminelle américaine diffusée entre 2022 et 2024 (3 saisons, en cours).
Bull est une série juridico criminelle américaine diffusée entre 2016 et 2022 (6 saisons).
Site des transcriptions : https://transcripts.foreverdreaming.org/
Chiara PREITE
Université de Milan (Italie)
La vulgarisation scientifique dans le Reel : le cas de la « fisica che ci piace »
La vulgarisation scientifique est désormais une activité sociale et communicative consolidée, produite par un médiateur-vulgarisateur qui s’adresse à un public de non experts, curieux et intéressés aux connaissances disciplinaires les plus diverses aussi bien comme moyen de culture que de distraction personnelle (Jacobi 1987 ; Grize 1987 ; Schiele, Larocque 1981). Comme le soutient Engberg (2020, p. 58), « popularization is more than just disseminating expert knowledge » pour les non experts, mais elle vise aussi à créer « a link to the popular culture of the receiver ».
A l’ère du numérique et de l’Internet omniprésent, la vulgarisation essaye de créer ce lien avec le destinataire par l’utilisation de canaux de diffusion capables d’atteindre les masses, comme les sites web et les réseaux sociaux. En particulier, nous nous intéressons à La fisica che ci piace (« La physique que nous aimons »), site consacré à la physique par Vincenzo Schettini, professeur du secondaire et désormais vulgarisateur célèbre , dont les contenus rebondissent et circulent entre plusieurs réseaux sociaux. Nous allons donc essayer de comprendre quels sont les enjeux communicatifs et linguistiques du grand succès obtenu par La fisica che ci piace.
D’un côté, c’est l’emploi des Reels, une fonctionnalité lancée par Instagram en 2020 permettant de créer des vidéos d’une durée brève, en format vertical et en plein écran. Les Reels proposent des contenus courts, divertissants et engageants, toujours faciles à consommer. La complicité captivante des vidéos et la facilité de partage et de circulation parmi plusieurs plateformes en font un véhicule idéal pour attirer l’attention du grand public.
Cependant, le format multimodal (Kress 2009 ; Kress, van Leuven 2001 ; Sagnier 2018) du Reel ne suffit pas pour fidéliser l’intérêt du public dans un but de vulgarisation scientifique. C’est donc aussi question de contenus : Schettini explique certains phénomènes qu’il est possible d’expérimenter dans la vie quotidienne par le recours à la physique, ce qui en met en relief l’utilité et les retombées sur la qualité de la vie . En effet, Schettini commence ses Reels en posant une question – stratégie dialogique par excellence, par exemple : Uovo nel microonde? Sì o no? (« œuf au micro-ondes ? Oui ou non ») – qui attire l’attention de l’internaute par la promesse d’une réponse simple mais compétente, introduite par : La fisica ci dice che… « La physique nous dit que… » (cf. Image).
Le dialogisme engage l’intérêt que le Reel contribue à accrocher, mais encore, il faut des explications synthétiques et claires des concepts en question, dans lesquelles entrent en jeu plusieurs stratégies de vulgarisation : le support de schémas et images (cf. Image) ; plusieurs types de reformulation intratextuelle, souvent avec joncteurs et marqueurs métalinguistiques ([…] microonde, ovvero onde elettromagnetiche emesse da un tubo a vuoto detto magnetron che rimbalzano in ogni direzione, « […] les micro-ondes, c’est-à-dire les ondes électromagnétiques émises par un tube à vide appelé magnétron, qui rebondissent dans toutes les directions ») ; dialogisation interlocutive avec le public (Mi sa che avete bisogno di un ripasso di fisica, « je crois que vous avez besoin d’une révision de physique »), etc.
Ainsi, nous allons concentrer l’attention sur la présentation de contenus de physique, afin d’analyser les stratégies dont le vulgarisateur se sert pour accrocher le public et le convaincre à le suivre, pour expliquer la terminologie spécialisée, et pour soutenir la construction cognitive des concepts scientifiques pour le grand public (Albertini, Delisle 1988).
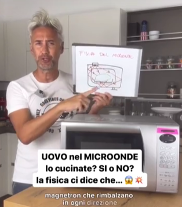
Mots clefs
Vulgarisation ; physique ; reformulation ; dialogisme ; Reels
Références bibliographiques
ALBERTINI, Jean-Marie, DELISLE, Claire, 1988, « Les fonctions de la vulgarisation scientifique et technique », in JACOBI, Daniel, SCHIELE, Bernard, Vulgariser la science. Le procès de l’ignorance, Seyssel, Champ Vallon, pp. 225-245.
ENGBERG, Jan, 2020, “Multimodal Institutional Knowledge Dissemination and Popularization in an EU Context. Explanatory Ambition in Focus”, in TESSUTO Girolamo, BHATIA, Vijay K., BREEZE, Ruth, BROWNLEES, Nicholas, SOLLY Martin (éds.), The Context and Media of Legal Discourse, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars, pp. 50-76.
GRIZE, Jean-Blaise, 1987, « Préface », in JACOBI, Daniel, Textes et images de la vulgarisation scientifique, Bern, Peter Lang, pp. 7-12.
JACOBI, Daniel, 1987, Textes et images de la vulgarisation scientifique, Bern, Peter Lang.
JANOT, Pascale, 2014, Les discours de vulgarisation économique à l’heure de la crise financière internationale, Roma, Aracne.
KRESS, Gunther, 2009. Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London, Routledge.
KRESS, Gunther, VAN LEUVEN, Theo, 2001, Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication, London, Hachette UK.
MERHY, Layal, 2010, « La vulgarisation dans les médias : sciences et émotions », in Commuinication, lettres et science du langage, n° 4 (1), pp. 29-41.
ORLANDI, Adriana, 2012, « Solare fotovoltaico e testi divulgativi. Un’analisi contrastiva, dal termine al testo », in GIAUFRET, Anna, ROSSI, Micaela (éds.), La terminologia delle energie rinnovalibili tra testi e repertori, Genova University Press, pp. 79-115.
PREITE, Chiara, 2013, « Comunicare il diritto: strategie di divulgazione del discorso giuridico », in BOSISIO Cristina, CAVAGNOLI Stefania (a cura di), Comunicare le discipline attraverso le lingue: prospettive traduttiva, didattica, socioculturale, Perugia, Guerra Edizioni, pp. 245-262
PREITE, Chiara, 2018, « La terminologie du notariat pour le grand public : transmission et reconstruction de connaissances spécialisées dans le site des notaires de France », in PREITE, Chiara, SILLETTI, Alida M. (éds.), La construction et la transmission des connaissances spécialisées dans le web, in ELA, Études de Linguistique Appliquée, n°192 (4), pp. 467-477.
SAGNIER, Christine, 2018, Des images et des mots … au XXIe siècle. Nou-velles perspectives sur la multimodalité, la communication visuelle et les multilittératies, Brussels, Peter Lang.
SCHIELE, Bernard, LAROCQUE, Gabriel, 1981, « Le message vulgarisateur », in Communications, n° 33, pp. 165-183.
https://www.lafisicachecipiace.com/
https://www.lafisicachecipiace.com/approfondimento/uovo-nel-microonde-si-o-no-la-fisica-ci-dice-che/
Natalia RIVA
Università Cattolica del Sacro Cuore (Italie)
Enhancing Health Literacy and Specialized Language Popularization through Chinese Medical TV Dramas
Numerous studies on medical TV series demonstrate their impact on society’s shared imagery. Staged diagnoses and procedures influence the viewers’ health knowledge and behaviors (Kim and Kim 2019, Pilz et al. 2020, Bitter et al. 2021), while dramatized key social relationships affect the public’s perception of hospitals and the patients’ trust in medical personnel (Chen 2019, 2020, Kohler et al. 2019, Tian and Yoo 2020). In the People’s Republic of China, ideological and political priorities – strictly linked to the State’s and Communist Party’s grip on cultural governance and propaganda – govern the production of audiovisual products, which are meant to foster political consensus and social cohesion by promoting narratives in line with the leadership’s objectives and national policies. In this framework, medical dramas, as a genre, are not simply entertainment but are embedded within the codified propagandistic and pedagogic mandate for TV entertainment (Cai 2016, 2017, Riva and Tarantino 2023, Zou 2023). These series often serve dual purposes: to educate the public on health-related topics, discussing social issues and providing practical and moral guidance, and to reinforce socialist values, such as patriotism and collective responsibility, as a base to build a well-functioning community, inside and outside the hospital. This strategy relies on the communicative power of the media to facilitate scientific knowledge dissemination and health literacy (Ren et al. 2021).
Taking the perspective of popularization discourse (Calsamiglia 2003) and edutainment (Feng 2016), this paper analyses a sample of Chinese contemporary medical TV dramas popular in the PRC since 2012 (心术, Angel Heart, 2012, 急诊科医生, ER Doctors, 2017, and 谢谢你医生, Thank You Doctor, 2022), with specific attention to the communication of health knowledge and medical terminology. Drawing on multimodal discourse analysis and textual analysis, the scenes showing instances of popularized medical discourse and practice will be examined on three levels: 1) identifying televised health knowledge through the diegetic and extradiegetic components of the storytelling, in order to explore the didactic function of medical dramas when conveying complex medical concepts in an engaging and accessible manner; 2) comparing differences in use of medical language among experts and between professionals and the general public, with the aim of unveiling power relations; and 3) observing the use of specialized terms, to highlight the role of medical TV series in explaining the evolving characteristics of the Chinese healthcare system to the audience through language.
Mots clefs
Chinese medical TV dramas ; health knowledge ; medical terminology; popularized medical discourse; edutainment
Références bibliographiques
Bitter, Cindy C., Neej Patel, and Leslie Hinyard (2021). “Depiction of Resuscitation on Medical Dramas: Proposed Effect on Patient Expectations.” Cureus 13(4): e14419. https://doi.org/10.7759/cureus.14419.
Cai, Shenshen (2016). State Propaganda in China’s Entertainment Industry. London: Routledge.
Cai, Shenshen (2017). Television Drama in Contemporary China. Political, Social and Cultural Phenomena. London: Routledge.
Calsamiglia, Helena (2003). “Popularization Discourse.” Discourse Studies 5(2), 139-146. https://doi.org/10.1177/1461445603005002307.
Chen, Li (2019). “Vulnerable Live Patients, Powerful Dead Patients: A Textual Analysis of Doctor-Patient Relationships in Popular Chinese Medical Dramas.” Cogent Arts & Humanities 6(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1622626.
Chen, Li (2020). “When Hippocrates Encountered Confucius:A Textual Analysis of Representations of Medical Professionalism on Chinese Medical Dramas.” China Media Research 16(1): 81-91.
Feng, Dezheng (2016). “Promoting moral values through entertainment: a social semiotic analysis of the Spring Festival Gala on China Central Television.” Critical Arts 30(1): 87-101. https://doi.org/10.1080/02560046.2016.1164387.
Kim, Hyang-Sook, and Kyongseok Kim (2019). “The Effects of Open Captions in a Medical Drama on the Acquisition of Medical Terminology about Chronic Health Conditions Related to Physical Injury.” American Journal of Health Education 50(5): 318-329. https://doi.org/10.1080/19325037.2019.1642267.
Kohler, Moritz, Claudia Forstner, Maximilian Zellner, and Michael Noll-Hussong (2019). “Bias by Medical Drama. Reflections of Stereotypic Images of Physicians in the Context of Contemporary Medical Dramas.” In Handbook of Popular Culture and Biomedicine, edited by Arno Gorgen, German Alfonso Nunez, and Heiner Fangerau, 337-349. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90677-5_25.
Pilz, Merle, Walter Stummer, and Markus Holling (2020). “Neurosurgery in Contemporary Medical Dramas: How Grey’s Anatomy & Co. May Affect Perception of Neurosurgery in the Media.” Journal of Neurological Surgery. Part A, Central European Neurosurgery 81(6): 495-500. https://doi.org/10.1055/s-0040-1709169.
Ren Fujun, Lin Yin, and Gauhar Raza (eds.) (2021). Science Communication Practice in China. Singapore: Springer.
Riva, Natalia, and Matteo Tarantino (2023). “The Politics of Fictional Medicine: Entertainment, Propaganda, and Education in Chinese Medical Dramas in the Xi Era.” In Investigating Medical Drama TV Series: Approaches and Perspectives. 14th Media Mutations International Conference, edited by Stefania Antonioni and Marta Rocchi, 1st ed. Media Mutations Publishing. https://doi.org/10.21428/93b7ef64.1b0951e7.
Tian, Yan, and Jina H. Yoo (2020). “Medical Drama Viewing and Medical Trust: a Moderated Mediation Approach.” Health Communication 35(1): 46-55. https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1536959.
Zou, Sheng (2023). “Restyling Propaganda: Popularized Party Press and the Making of Soft Propaganda in China, Information.” Communication & Society 26(1): 201-217. https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1942954.
Micaela ROSSI
Université de Gênes (Italie)
Des métaphores visuelles dans la vulgarisation scientifique : deux études de cas dans un corpus de bandes dessinées
Notre communication se propose d’analyser les enjeux sémiotiques et épistémologiques liés à l’emploi de métaphores visuelles dans les bandes dessinées destinées à la vulgarisation scientifique.
L’emploi de la bande dessinée dans le domaine de la vulgarisation est désormais une pratique reconnue. De nombreuses études (Baudry et Crépin, 2020, Farinella, 2018, Marc et Richardier, 2023) soulignent le rôle fondamental que la BD peut jouer dans des contextes de diffusion des recherches scientifiques auprès du grand public, indépendamment de l’âge des lecteurs et lectrices. Raux (2017) en arrive à postuler l’avènement d’un nouveau genre, celui du documentaire graphique. La BD sort ainsi dans ce domaine du stéréotype de texte simplifié, adapté pour un public d’enfants, et elle acquiert le statut privilégié de médium de vulgarisation scientifique à tous les niveaux, des contextes scolaires au grand public des amateurs des sciences de tous âges et profils.
Dans le cadre de l’analyse sémiotique de la BD de vulgarisation scientifique, les métaphores visuelles se taillent la part du lion ; qu’il s’agisse de métaphores visant la représentation d’objets précis (il suffit de penser à ce propos aux multiples visualisations du coronavirus pendant la pandémie de Covid-19 - voir l’exemple 1 ci-dessous) ou de métaphores visuelles qui racontent une vraie et propre histoire (comme dans le cas des effets de l’émergence climatique, voir l’exemple 2 ci-dessous), la métaphore accomplit sa tâche principale, celle de permettre l’accès à des concepts abstraits, visant l’infiniment grand, l’infiniment petit, un processus naturel ou social complexe - en d’autres mots, des concepts qui seraient difficilement accessibles à un large public qui n’est pas composé d’experts.
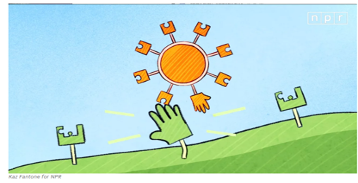
Exemple 1. Métaphore visuelle représentant le fonctionnement des protéines

Exemple 2. Exemple de métaphore visuelle - le processus du réchauffement climatique
Toutefois, si la métaphore peut garantir un accès facilité aux concepts scientifiques, elle peut également en fournir des visions partielles, voire même biaisées. Le processus de highlighting propre du raisonnement métaphorique, ultérieurement amplifié par le passage de la métaphore verbale au dessin, peut engendrer des points de vue différents sur les objets scientifiques décrits. Qui plus est, la métaphore visuelle est souvent liée à un interdiscours commun, à une encyclopédie partagée, variant d’une culture à l’autre, d’une génération à l’autre, subissant des effets de mode, ce qui peut représenter une difficulté ultérieure et parfois une limite dans la communication des savoirs scientifiques au grand public.
Sur la base d’un corpus de BD en langue française concernant deux événements d’extrême actualité (la pandémie de Covid-19 et l’émergence climatique), nous nous proposons donc d’analyser les formes et les fonctions que la métaphore visuelle peut assumer, ainsi que les atouts et les risques que cette stratégie de transmission des savoirs scientifique sous-tend.
Mots clefs
Métaphores visuelles ; vulgarisation scientifique ; bande dessinée ; Covid-19 ; émergence climatique
Références bibliographiques
Baudry, J., Crépin, O. (2020). « La fabrique de recherche dessinée ». In Actes de la 2e édition du colloque international Telling Science, Drawing Science, TSDS (Vol. 2, pp. 140-147).
Brown, Th. L. (2003). Making Truth. Metaphor in Science. Illinois University Press.
Farinella, M. (2018). « Science comics’ super powers ». Am Sci, 106(4), 218.
Forceville, C. (2016). « Conceptual metaphor theory, blending theory, and other cognitivist perspectives on comics ». The visual narrative reader, 89-114.
Giordano, I. (2024). « Scientific popularization for ecological awareness: when climate science meets comic art ». La torre di Babele.
Haack S. (2019). « The Art of Scientific Metaphors », Revista Portuguesa De Filosofia, 75 (4), pp. 2049-2066.
Houdement, C. de Hosson, C. Hache, C. (2022). Approches sémiotiques en didactique des sciences, London, ISTE Group.
Jacobi, D. (2023). Communication scientifique et technique. https://publictionnaire.huma-num.fr/wp-content/uploads/2023/12/figurabilite-des-concepts-dans-la-communication-scientifique-et-technique.pdf
Jürgens, A. S., & Clitheroe, C. L. (2024). “Matteo Farinella: Illustrated Science Communication & Visual Science Storytelling ». w/k-Zwischen Wissenschaft & Kunst.
Marc, C., Richardier, V. (2023). « Mettre en dessins le travail scientifique », Images du travail, travail des images, http://journals.openedition.org/itti/3680 (cons. le 26/10/2024).
Raux, H. (2017). « Bande dessinée et diffusion des savoirs : l’avènement du documentaire graphique ? », Rencontres Nationales de la Bande Dessinée #2 : Bande dessinée et éducation, Oct 2017, Angoulême, France.
Robert, P. (2015). « Professeure Moustache contre les médias », Comicalités http://journals.openedition.org/comicalites/2111
Temmerman R. (2022), «Terminological metaphors: Framing for better and for worse…», in Prandi M., Rossi M. (eds.), Researching Metaphors: Towards a Comprehensive Account, Routledge, London, pp. 111-131.
Marine VERRIEST
Université de Namur (Belgique)
L’hypothèse Sapir-Whorf au prisme de la science-fiction
Selon l’hypothèse Sapir-Whorf (parfois désignée sous le nom de « théorie de la relativité linguistique » [Reines, M. F., Prinz J., 2006]), la langue influence la façon de percevoir et de conceptualiser le monde. Bien qu’elle suscite beaucoup de scepticisme parmi les linguistes (Gebert, L., 2012 ; Joseph J. E., 1996), cette théorie a connu une diffusion remarquable en dehors de l’université. Elle a trouvé un écho dans la culture populaire, en particulier dans la littérature de l’imaginaire (Landragin, F., 2018). Mais que reste-t-il de la théorie initiale une fois qu’elle a traversé le filtre de la fiction ?
L’objectif de cette communication est d’explorer comment l’hypothèse whorfienne a été vulgarisée et transformée au sein de la littérature de l’imaginaire. Notre corpus, conçu dans une volonté de dresser un panorama de la « linguistique-fiction » (Dutel, J., 2015) à travers les décennies, est composé de quatre textes de fiction édités entre la fin des années 1950 et aujourd’hui : The Languages of Pao de Jack Vance (1958), Babel 17 de Samuel R. Delany (1966), Story of Your Life de Ted Chiang (1998) et Embassytown de China Miéville (2011).
Notre communication s’articulera autour de deux volets. Dans le premier, nous étudierons comment l’hypothèse Sapir-Whorf sert les auteurs de fiction comme source spéculative et comment elle peut devenir un ressort narratif (Landragin, F., 2023). Le second volet consistera à comparer les écrits académiques originaux d’Edward Sapir (Sapir, E., 1929) et de Benjamin Whorf (Whorf, B., 1956) aux œuvres de notre corpus. L’hypothèse Sapir-Whorf n’ayant jamais été formalisée en tant que telle par les linguistes à qui elle est attribuée, ce que l’on désigne sous ce terme est davantage le résultat d’une interprétation a posteriori de leurs idées (Kay, P., Kempton, W., 1984).
Par cette démarche, nous proposerons une réflexion sur les enjeux de la vulgarisation des théories linguistiques dans la fiction. Si la science-fiction a largement contribué à populariser l’hypothèse Sapir-Whorf, elle en a aussi fait un objet malléable, souvent éloigné des sources qui l’ont fait naître.
Mots clefs
Hypothèse Sapir-Whorf ; linguistique ; fiction ; science-fiction ; vulgarisation
Références bibliographiques
Chiang, T., 2002 [1998], Story of Your Life and Others, New York, Tor Books.
Delany, S. R., 2010 [1966], Babel 17, Londres, Orion Publishing.
Dutel, J., 2015, « Fiction linguistique ou linguistique-fiction ? », dans Besson, A. et Jacquelin, E. (dir.) Poétique du merveilleux : fantastique, science-fiction, fantasy.
Arras, Artois Presses Université, p. 89-103.
Gebert, L., 2012, « Le caractère national dans la langue et la typologie linguistique » dans Cahiers de l’ILSL, n°33, p. 101-112.
Joseph J. E., 1996, « The Immediate Sources of the ’Sapir-Whorf Hypothesis » dans Historiographia Linguistica, vol. 23, n°3, p. 365-404
Kay, P., Kempton, W., 1984, « What Is the Sapir-Whorf Hypothesis? » dans American Anthropologist New Series, vol. 86, n°1, p. 65-79
Landragin, F., 2018, Comment parler à un alien ? Langage et linguistique dans la science-fiction. Saint Mammès, Le Bélial’.
Landragin, F., 2023, « Les Langages de Pao de Jack Vance et le pouvoir linguistique », dans Pouvoirs, responsabilités et cas de conscience en science-fiction, p. 179-198. URL : https://hal.science/hal-04212712v1
Miéville, C., 2011, Embassytown, New-York, MacMillan Publishers.
Reines, M. F., Prinz J., 2006, « Reviving Whorf: The Return of Linguistic Relativity » dans Philosophy Compass, vol. 4, n°6, p. 1022-1032.
Sapir, E., 1929, « The Status of Linguistic of a Science », dans Language, vol. 5, n°4, p. 207-214.
Vance, J., 1974 [1958], The Languages of Pao, New-York, HarperCollins.
Whorf, B., 1956, Language, Thought, and Reality: Selected Writing of Benjamin Whorf, éd. J. B. Carrol, Cambridge, MIT Press.
Doan VU DUC
Université de Namur et Université de Mons (Belgique)
Gloria ZANELLA
Université de Modène et de Reggio d’Emilie (Italie) et Université de Genève (Suisse)
Les métaphores dans les ouvrages de vulgarisation de Carlo Rovelli : une étude sur corpus parallèle en français et italien
Selon Aristote, la métaphore est un transfert d’un concept dans un domaine étranger (Poétique). Quintilien définit la métaphore comme une similitude ou une comparaison abrégée (“metaphora brevior est similitudo”, Institutio oratoria, VIII, 6, 8). Prandi reprend l’image de la métaphore considérée comme « propria oves in rure alieno » par Geoffroy de Vinsauf (1924) pour éclaircir le processus du transfert : il explique qu’au moment où la brebis est dans un pré qui n’est pas le sien, son aventure commence et plusieurs scénarios peuvent se manifester (Prandi, 1992 ; 2002 ; 2021). Au XX siècle, la dimension cognitive de la métaphore a connu son développement grâce aux études menées par Richards (1936), Black (1962 ; 1993 [1979]), Boyd (1993 [1979]), Kuhn (1993 [1979]) qui ont déplacé le focus sur l’interaction conceptuelle. La distinction proposée par Boyd (1993 [1979]) entre les métaphores « constitutives de théories » et les métaphores « illustratives » s’avère fondamentale pour les développements de cette recherche. Les métaphores constitutives de nouveaux concepts permettent un accès épistémique aux teneurs par le biais de la projection et elles ne peuvent pas être remplacées par des expressions non métaphoriques car elles représentent le concept nommé. L’autre groupe élaboré par Boyd concerne les métaphores illustratives ou pédagogiques qui trouvent leur fondement sur l’analogie et permettent la circulation de concepts indépendants et préexistants, facilitant aussi l’explication des théories pour le public de non-experts.
La vulgarisation scientifique (Jacobi & Schiele, 1988) permet la transmission des connaissances et la circulation des découvertes scientifiques auprès du grand public. Les définitions concernant la vulgarisation visent à circonscrire son champ d’usage et elles sont fondées sur des critères externes (Authier, 1982). Selon Beaune la vulgarisation est caractérisée par deux composantes : d’un côté, elle est une communication de science ; de l’autre côté, elle est « un bricolage conceptuel agrémenté des audaces de l’image » (Beaune, 1988 : 76).
Cette recherche se propose d’analyser les rôles que la métaphore joue dans les ouvrages de vulgarisation sur la physique et la mécanique quantique écrits en italien par le physicien théorique Carlo Rovelli : Sette brevi lezioni di fisica (2014), L’ordine del tempo (2017), Buchi bianchi dentro l’orizzonte (2023) et leurs traductions en français Sept brèves leçons de physique par Patrick Vighetti, L’ordre du temps par Sophie Lem, Trous blancs par Matteo Smerlak. Nous aborderons la question de la métaphore dans la vulgarisation qui facilite l’accès des contenus au public de non-spécialistes, nous considérons l’usage des typologies de métaphores par l’auteur et nous explorons les stratégies traductives choisies par les traducteurs (Vinay & Darbelnet, 1958 ; Hurtado Albir, 2001). La méthodologie de détection des métaphores que nous utilisons est la MIPVU (Pragglejaz Group, 2007 ; Steen et al. 2010 ; Nacey et al. 2019) afin relever l’usage métaphorique dans le contexte. Le logiciel choisi pour l’analyse du corpus parallèle est Sketch Engine. Enfin, nous proposons des réflexions sur la nature des métaphores dans la vulgarisation et leur rôle dans le partage des notions scientifiques avec le public profane.
Mots clefs
Métaphores constitutives de théories ; métaphores pédagogiques ; langues de spécialité ; vulgarisation ; corpus parallèle
Références bibliographiques
Aristote. Poétique, trad. fr., Hardy, J. (1969 [1932]). Paris : éd. Les Belles Lettres.
Authier, J. (1982). La mise en scène de la communication dans des discours de vulgarisation scientifique. Langue française, 53, 34-47
Beaune J.-C. (1988). La vulgarisation scientifique. L’ombre des techniques. Dans D. Jacobi, & B. Schiele (dir.), Vulgariser la science. Le procès de l’ignorance, pp. 47-76. Seyssel, Éditions Champ Vallon.
Black, M. (1962). Models and Metaphors. Ithaca, New York : Cornell University Press.
Black, M. (1993 [1979]). More about metaphor. Dans A. Ortony (éd.), Metaphor and Thought, 19-43. Cambridge : Cambridge University Press.
Boyd, R. (1993 [1979]). Metaphor and theory change: what is “metaphor”, a metaphor for?. Dans A. Ortony (éd.), Metaphor and Thought, pp. 481-532. Cambridge : Cambridge University Press.
Hurtado Albir A. (2001). Traducción y Traductología : Introducción a la Traductología, Madrid, Cátedra.
Jacobi, D., & Schiele, B. (1988). Vulgariser la science. Le procès de l’ignorance. Seyssel : Éditions Champ Vallon.
Kuhn, Th. S. (1993 [1979]). Metaphor in science. Dans A. Ortony (éd.), Metaphor and Thought, pp. 409-419. Cambridge : Cambridge University Press.
Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. & Reijnierse W. G. (Éds.). (2019). Metaphor Identification in Multiple Languages, pp. 69-90. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins.
Pragglejaz Group. (2007). MIP : A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. Metaphor and Symbol, 22 (1), 1-39. DOI : 10.1080/10926480709336752
Prandi, M. (1992). Grammaire philosophique des tropes. Paris : Éditions de Minuit.
Prandi, M. (2002). La métaphore : de la définition à la typologie. Langue française, 134, Nouvelles approches de la métaphore, 6-20.
Prandi, M. (2021). Le metafore tra le figure: una mappa ragionata. Turin : UTET Università.
Quintilien. Institutio oratoria. E. D’Incerti Amadio & S. Beta (a cura di), Vol. 2, Livres VII-XII. Milano : Mondadori, 2007.
Richards, I. A. (1936). The Philosophy of Rhetoric. Oxford : Oxford University Press.
Steen., G., Dorst A. G., Herrmann J. B., Kaal A. A., Krennmayr T., & Pasma T. (2010). A method for linguistic metaphor identification from MIP to MIPVU. Amsterdam : John Benjamins.
Vinay J.-P., Darbelnet J. (1958). Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier, Londres, Harrap, Montréal, Beauchemin.
Vinsauf de G. (1924). Poetria Nova, in E. Faral, Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècles, Paris : Champion.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Site Web © 2024 Charlène Meyers
Comment les Schtroumpfs font-ils pour se schtroumpfer quand ils schtroumpfent ? / (Comment les Schtroumpfs font-ils pour se comprendre quand ils parlent ?)
Cette question, d’apparence banale, reflète une grande question de la philosophie du langage : comment nous, humains, parvenons-nous à nous comprendre ? Comment un mot, un simple son peut-il transmettre un sens commun à des individus qui ne partagent pas les mêmes expériences ni les mêmes perceptions ?
C’est à ce type de question que cette branche de la philosophie cherche à répondre en explorant la manière dont les mots, les phrases et les signes véhiculent des significations dans notre vie quotidienne. Cette présentation consistera en un exercice de vulgarisation de deux grandes postures en philosophie du langage illustrées par des exemples tirés d’un peuple bien connu : les Schtroumpfs. À l’aide des petits êtres bleus et de leur langage incompréhensible pour le commun des mortels, nous explorerons ces grandes questions.
La question que nous poserons est « comment est-ce que les Schtroumpfs s’accordent sur la définition d’un mot ? ». La première posture est la réponse traditionnelle à cette question. Traditionnellement, la définition d’un mot est ce qui valide un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes de ce mot. En termes plus techniques, on dit que la signification est une propriété précise de chaque mot et indépendante du contexte d’utilisation. Cette conception traditionnelle suppose qu’il y ait un accord implicite entre les personnes qui parlent la même langue sur les conditions nécessaires et suffisantes de chaque mot bien défini.
Parmi les philosophes les plus influents en philosophie du langage, Ludwig Wittgenstein est considéré comme l’un des grands du 20ème siècle, et propose une deuxième posture. Il se demande : si vraiment il y a un accord sur les conditions nécessaires et suffisantes pour définir chaque mot, quel Schtroumpf qui décide de la signification ? Et comment sommes-nous sûrs de parler de la même chose quand on dit d’une chose qu’elle est « rouge » (ou qu’elle est « Schtroumpfante ») ?
Dans ses Recherches Philosophiques, Wittgenstein propose une approche où le sens des mots équivaut à leur usage. La signification n’y est pas une propriété fixe et objective attachée à un référent extérieur comme le suppose l’approche traditionnelle ; mais plutôt quelque chose qui émerge de leur usage dans des contextes sociaux et des pratiques particulières qu’il appelle « jeux de langage ».
Dans cette conférence, nous explorerons cette idée qui considère que le sens des mots ne se trouve pas dans des définitions abstraites mais dans des « jeux de langage » sociaux, rendant la signification une propriété dynamique, non-fixe, dépendante de l’usage, en montrant comment Wittgenstein a rompu avec la tradition dans un exercice de vulgarisation d’histoire de la philosophie du langage.